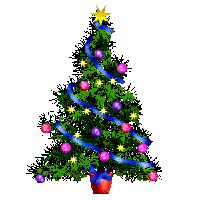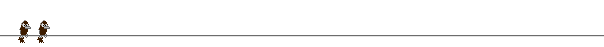
Autres traditions au fil de l’année…
|
P E N T E C Ô T E
Une semaine avant Pâques, on célébrait les « Pâques fleuries », c’est-à-dire le dimanche des Rameaux (Palmsonntag) qui commémore l’entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem.
Chaque fête chrétienne est associée à une spécialité culinaire : la Chandeleur aux crêpes ; Mardi gras aux gaufres et aux beignets (Krapfen) ; Pâques au gigot d’agneau (Lammkeule), aux oeufs et au chocolat ; Noël à l’oie (Gans) ou à la dinde aux marrons (mit Kastanien gefüllte/r Pute/Truthahn), et – en Provence – aux « 13 desserts » ; l’Epiphanie à la galette ou au gâteau des Rois… La Pentecôte n’échappe pas à (keine Ausnahme bilden) cette tradition, même si le gâteau confectionné à l’occasion de cette fête, le Colombier, est moins connu. (► photo d’illustration) Il doit son nom au fait que, comme le gâteau des Rois, il contient une fève, mais en forme de colombe : cet oiseau symbolise non seulement la paix, mais aussi le Saint-Esprit. Le gâteau a une forme ovale, celle de la mandorle (en architecture et en peinture, c’est une figure en forme d’amande dans laquelle sont inscrits les personnages sacrés, le plus souvent le Christ) qui est aussi celle de l’œuf, tout un symbole !
D’après le mythe fondateur (Gründungssage) de la ville de Marseille, le premier Colombier aurait été confectionné par Gyptis, la fille du chef des autochtones Ségobriges (peuple celto-ligure) : elle y aurait dissimulé (verstecken) une figurine en forme de colombe, promettant d’épouser celui qui la trouverait. C’est ainsi que Protis, un marin originaire de Phocée, s’est marié avec la princesse et qu’ils ont fondé Massalia, future Marseille. La tradition du gâteau de Pentecôte a été « récupérée » (für seine eigenen Zwecke nutzen, recyceln) par un pâtissier parisien qui le commercialise (vermarkten, vertreiben), accompagné d’une notice explicative rappelant la légende. Dans la version « francilienne », c’est Sainte-Geneviève, patronne de Paris, qui après avoir incité la population de Lutèce à résister à l’envahisseur (Invasor, Eindringling) Attila, a vu une colombe – annonciatrice (Vorbote) de paix – se poser sur son épaule. |
| M U G U E T
En France, le 1er Mai, il est de tradition d’offrir du muguet porte-bonheur (surtout s’il a 13 clochettes…) Pourquoi du muguet ? Parce que c’est une fleur qui fleurit à cette époque de l’année (même si, avec le réchauffement climatique, le muguet a tendance à éclore de plus en plus tôt…) Il paraît que cette coutume date de la Renaissance : en 1560, le roi Charles IX et sa mère Catherine de Médicis étaient en visite dans le Dauphiné. A Saint-Paul-Trois-Châteaux, un chevalier leur a offert du muguet cueilli dans son jardin. Ravi, le monarque a repris l’idée en offrant chaque printemps le premier mai un brin de muguet aux dames de la cour. Bien entendu, la coutume n’a pas tardé à se répandre dans tout le royaume. Il semblerait que cette tradition se soit un peu perdue au cours des siècles. Ce qui est sûr, c’est qu’elle a été redécouverte à la fin du XIXe siècle par le chansonnier Félix Mayol (l’auteur de l’immortel « Viens Poupoule » !) originaire de Toulon – et dont le patronyme semble prédestiné (Nomen est omen…) puisque le nom scientifique du muguet est « convallaria maialis« ! Son amie parisienne, Jenny Cook, l’accueille à la Gare Saint-Lazare avec un bouquet de muguet. Le soir de sa première sur la scène du Concert parisien, il porte un brin de muguet à sa boutonnière, à la place du traditionnel camélia. Comme sa série de concerts est un véritable triomphe, il décide d’adopter le muguet comme emblème. Au début du XXe siècle, à la Belle Epoque (c’est-à-dire dans les années d’avant la guerre de 14-18), les grands couturiers offrent le 1er mai du muguet à leurs clientes et à leurs « petites mains » (les couturières). Christian Dior en fait même l’emblème de sa maison de couture. Si vous voulez en savoir plus sur le muguet… • Le 1er Mai, particuliers et associations sont autorisés à vendre du muguet, à condition qu’il ait été cueilli dans un jardin privé ou dans les bois… et qu’il soit vendu au moins à 40 m de la boutique d’un fleuriste. Mais en 2020 et 2021 – pandémie oblige – ces ventes dites « à la sauvette » étaient interdites. • Attention, tout est toxique dans le muguet : feuilles (qu’il ne faut pas confondre avec celles de l’ail des ours (Bärlauch), clochettes, baies ! Leur ingestion risque provoquer des troubles du rythme cardiaque qui peuvent s’avérer fatals. • Le muguet est devenu l’emblème du Rugby Club Toulonnais (RCT) (en hommage à Félix Mayol, né à Toulon et mécène du club). • C’est également un des symboles de la Finlande (le muguet est en effet une plante qui ne craint pas le froid…) • Son nom français – comme le mughetto italien – dérive de musc (Moschus), en raison de l’odeur de ses fleurs. • Il possède en français divers noms vernaculaires (usuels, non scientifiques) : clochette des bois, grillet, grelot-(Schelle), termes qui rappellent la forme campanulée (en forme de cloche) de ses fleurs et sont proches de sa dénomination en allemand : Maiglöckchen. • Son nom scientifique « convallaria maialis » (« qui pousse en mai dans les vallées ») rappelle sa désignation – en anglais : Lily of the valley ; – en espagnol : lirio de los valles ; – ou en portugais : liro-do-vale. |
| En 2021, le Poisson d’Avril… est tombé à l’eau !
Outre le fait que la gravité de la crise sanitaire ne rendait pas l’ambiance propice aux blagues, les médias ont voulu éviter de faire circuler des informations fantaisistes susceptibles d’être prises pour argent comptant (für bare Munze). Depuis, les traditionnelles fausses informations du 1er avril se font rares dans la presse. A l’ère des fake news (« infox »), deepfakes (« hupertrucage ») et images générées par l’intelligence artificielle, beaucoup de médias préfèrent y renoncer. |
| N O Ë L et P Â Q U E S
Toute une série de dictons assurent que, s’il fait beau et doux à Noël, cela annonce du froid pour Pâques. Noël au balcon, Pâques aux tisons (glimmendes Holzstück). A Noël les moucherons, à Pâques les glaçons. Soleil à Noël, neige à Pâques. A Noël la chaleur, à Pâques la froideur. Qui prend le soleil à Noël, à Pâques se gèle. Quand tu prends à Noël le soleil, à Pâques te rôtis l’orteil. Verte fête de Noël, blanche fête de Pâques… On trouve des dictons comparables en allemand : Ein grüner Christtag, ein weißer Ostertag. Grüne Weihnachten, weiße Ostern. D’après Météo France, ces dictons – pourtant unanimes, ce qui est rare pour les proverbes météorologiques ! – n’ont aucun fondement scientifique… Ils sont d’autant moins fiables (verlässlich) que, si Noël tombe toujours le 25 décembre, la date de Pâques, elle, est mobile (entre le 22 mars et le 25 avril). Réchauffement climatique oblige, ces dernières années les températures ont été plutôt douces, voire très douces, à Noël, en France comme en Autriche. Mais nous n’avons pourtant pas été obligés de passer « Pâques aux tisons », sauf en 2017 où le mois d’avril a été le plus frais depuis 9 ans. |
| A R B R E de N O Ë L
Les premiers arbres de Noël apparaissent en Alsace au XVe siècle. La région n’est pas française à cette époque : elle fait encore partie du Saint Empire romain germanique. Cette nouvelle coutume est d’abord nommée « Mai d’hiver », car c’est en réalité la récupération par l’Eglise chrétienne d’un rite païen de fécondité, celui de l’Arbre de maique l’on plantait au printemps. La plupart des fêtes chrétiennes (Noël, la Chandeleur, la Toussaint, la Saint-Valentin… pour n’en citer que quelques-unes) sont d’ailleurs d’anciennes fêtes païennes. La tradition de l’Arbre de mai a évolué : alors que c’était un arbre vivant à l’origine, depuis le XVIe siècle, c’est un mât (tronc d’arbre dépourvu de branches) qui est planté dans la terre, le Maibaum>, tel qu’i est encore connu dans l’espace germanique aujourd’hui. Aux XVI-XVIIe siècles, l’arbre de Noël est rarement un sapin : – d’une part, il s’agit souvent d’autres végétaux à feuilles persistantes (immergrün) (comme l’olivier, le buis, le houx / Stechpalme, le laurier… dont le feuillage reste vert en hiver), – d’autre part, ce sont plutôt des branches ou des rameaux (Zweig) que des arbres entiers. La tradition de l’arbre de Noël se développe chez les protestants allemands pour se démarquer (sich abgrenzen) des catholiques qui, eux, privilégiaient la tradition de la crèche avec ses santons (les « petits saints »). Et, en effet, ce sont des princes et princesses de culture germanophone et protestante qui vont l’introduire progressivement dans les cours d’Europe occidentale : – 1er essai à Versailles avec la Princesse palatine (aus der Pfalz), Elisabeth-Charlotte, belle-sœur de Louis XIV, – Nouvelle tentative en 1738, avec Marie Leszcynska, femme de Louis XV, d’origine polonaise. Mais, apparemment, ces deux premières « importations » ne sont pas couronnées de succès, puisque, en 1837, la cour semble redécouvrir la tradition de l’arbre de Noël avec la duchesse d’Orléans, née Hélène de Mecklembourg. – A Vienne, c’est la princesse Henriette de Nassau-Weilburg (une calviniste), épouse de l’archiduc Charles d’Autriche (frère de l’empereur François 1er), qui fait découvrir l’arbre de Noël à la cour en 1816, – En Angleterre, c’est le prince Albert, époux de la reine Victoria, qui introduit (en 1841) cette tradition provenant de sa Saxe natale.. Mais après la guerre franco-prussienne de 1870 et l’annexion de l’Alsace-Moselle, ce sont les « optants » (= les habitants de ces départements, qui ont choisi de rester français et qui sont obligés de quitter leur patrie devenue allemande) qui vont diffuser cette coutume dans l’Est de la France. Avec le temps, les pommes rouges qui ornaient l’arbre sont remplacées par des boules de verre (puis de plastique…), les guirlandes électriques se substituent aux bougies de cire (au grand soulagement des pompiers…), les papillottes (Knallbonbon) et autres friandises (Leckereien) prennent la place des fleurs, noix peintes et décorations en paille. Les régions du Midi ont résisté plus longtemps à l’invasion du sapin de Noël : en Provence, jusqu’à la fin des années 1960, on fêtait Noël sans arbre et sans Père Noël. C’était l’Enfant Jésus qui descendait par la cheminée pour déposer des cadeaux dans les souliers disposés devant, dans un ordre dépendant de l’âge de leur propriétaire : des chaussons du petit dernier de la famille jusqu’aux chaussures du grand-père. Et puis le Sapin est arrivé, suivi un peu plus tard de la Couronne de l’Avent. Rien ne résiste à la mondialisation des traditions ! |
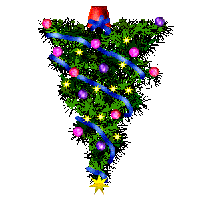 SAPIN de NOËL à l’envers !
Un monde qui marche sur la tête (Kopf stehen) ? SAPIN de NOËL à l’envers !
Un monde qui marche sur la tête (Kopf stehen) ?
Ce sont les grands magasins qui ont lancé (einführen) cette nouvelle mode – pour des raisons de marketing, bien entendu : cela permet d’accrocher les décorations et les autres articles à vendre à la hauteur des yeux des clients etde dégager suffisamment de place au sol pour y présenter d’autres produits. Ces dernières années, ce sont les particuliers qui ont adopté le « sapin à l’envers » : l’arbre est ainsi moins encombrant (platzraubend) et hors de portée (außer Reichweite) des jeunes enfants et des animaux domestiques. En outre, comme c’est un sapin artificiel (en effet, un « vrai » arbre serait trop lourd et exigerait une fixation plus robuste), il ne perd pas ses aiguilles et il est économique, car il peut être réutilisé chaque année (jusqu’à ce que la mode passe…) Beaucoup estiment que le sapin à l’envers bafoue la tradition. Certains y voient même un sacrilège et rappellent le rite satanique de la croix à l’envers. D’autres se demandent avec inquiétude jusqu’où ça va aller : verra-t-on bientôt le Père Noël pendu par les pieds ? Et pourquoi pas les rennes ? Et, qu’en est-il (wie steht es mit) des bougies ? Heureusement qu’en France on décore surtout le sapin de Noël avec des guirlandes électriques ! Mais en Autriche ? L’exemple à ne pas imiter ! La municipalité de Graz a voulu suivre cette mode, mais n’a pas compris qu’il fallait pendre le sapin par le pied et pas par le sommet. Résultat : les arbres de Noël qui pendouillent (herumbaumeln) tristement dans la capitale styrienne ont un aspect sinistre (unheimlich) – pour ne pas dire macabre – pendant la journée, quand ils ne sont pas illuminés. Au fait (übrigens), le sapin à l’envers n’est pas une invention du XXIe siècle : c’est une tradition qui existe depuis des siècles dans l’Est de l’Europe. En Autriche aussi, certains se souviennent que dans leur enfance – surtout en milieu rural – l’arbre de Noël était suspendu au plafond : d’une part pour échapper aux animaux qui vivaient dans la ferme et d’autre part pour ne pas encombrer (versperren) la salle commune (à une époque où elle servait de lieu de rassemblement pour toute la famille). |
|
8 décembre – Fête des Lumières à Lyon Le 8 décembre n’est pas férié en France. Mais ce jour-là, Lyon célèbre « La Fête des Lumières« , inspirée des festivités religieuses traditionnelles de l’Immaculée Conception. Depuis 1989, la ville est illuminée pendant quatre jours aux environs du 8 décembre. Touchée par la peste, Lyon s’est mise sous la protection de la Vierge Marie en 1643 : les notables de la ville ont fait le vœu de rendre chaque année hommage à Marie si elle faisait cesser l’épidémie. La peste passée, Lyon a tenu sa promesse et depuis, chaque année, un cortège solennel défile de la cathédrale Saint-Jean (au centre de la ville) jusqu’au sanctuaire de la Vierge (aujourd’hui jusqu’à la basilique Notre-Dame) situé sur la colline de Fourvière. A l’origine, cette cérémonie avait lieu le 8 septembre, jour de consécration de la ville à la Vierge et jour de la fête de sa Nativité. En 1852, en raison des intempéries, la fête n’a pas pu avoir lieu et a été repoussée au 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception (célébrée depuis le IXe siècle mais proclamée comme dogme seulement en 1854). Selon la tradition, chaque famille lyonnaise met ses « lampions » ou « lumignons » (bougies courtes abritées dans un petit récipient en verre épais) sur le rebord de ses fenêtres. Cette coutume a tendance à disparaître… la « Fête des lumières » lui fait de l’ombre ! A partir de 1999, la fête est institutionnalisée et l’événement ne cesse de prendre de l’ampleur : des animations importantes (procession et montée aux flambeaux vers la basilique, feux d’artifice, illuminations des rues et des commerces des vieux quartiers, spectacles « son et lumière »…) sont organisées par la municipalité, attirant chaque année des millions de visiteurs (4 millions en 2012). La Fête a dû être annulée, une première fois, en 2015, après les attentats du 13 novembre en Île-de-France. Et une deuxième fois en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19. (d’après Wikipédia) |
|
La paraskevidékatriaphobie, c’est l‘angoisse du vendredi 13 (du grec paraskevi = « vendredi » + dekatreis = « treize » + phóbos = « peur »).Cette superstition – qui remonterait aux origines de la Chrétienté – a fait de cette date, dans certaines cultures, un jour de malheur. En effet, c’est parce que, d’une part, le Christ a été crucifié un vendredi et que, d’autre part, la veille, lors du repas sacré de la Cène, il était accompagné de ses 12 Apôtres – parmi lesquels Judas Iscariote, qui devait le trahir et le livrer la nuit-même – qu’est née l’idée d’un mauvais présage annoncé par la présence de 13 convives. |
| A D V E N T, stiller Advent...
L’Avent devrait être une période calme et recueillie (andächtig), où l’on se prépare à la fête de Noël. Mais, le plus souvent, c’est l’effervescence (Hektik) qui règne : c’est le cas à Pörtschach (en Carinthie) où, pour la dixième année consécutive, la municipalité fête l’Avent avec des illuminations (Festbeleuchtung), un marché de Noël, de la musique… En 2019, les responsables ont fait de la publicité en plusieurs langues pour ces festivités. Mal leur en a pris ! (das ist ihnen schlecht bekommen). Le message « Tradition beim Stillen Advent in Pörtschach » s’est transformé en anglais en « Tradition at the Advent Breastfeeding« . Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances très étendues dans cette langue pour comprendre que le terme « Breastfeeding » n’a rien à voir avec l’adjectif « still » puisque, composé de « breast » (la poitrine, le sein / Brust) et de « feeding » (action de nourrir), il signifie « allaitement, alimentation au sein »… tout comme le substantif allemand Stillen ! (article de la Kleine Zeitung) (► vidéo) N’ayant pas trouvé sur Internet la version française de cette campagne publicitaire lancée par la Tourismusregion Wörthersee, j’ignore si « stiller Advent » a été traduit par « allaitement pendant l’Avent » ou si les responsables ont découvert l’erreur de traduction à temps… Certains se demandent d’ailleurs s’il s’agit vraiment d’une » gaffe » (Fauxpas) et soupçonnent les promoteurs de cette campagne d’avoir volontairement mal traduit le mot « still » pour faire le buzz (Hype, Wirbel). Cette « publicité » va-t-elle attirer à Pörtschach des Anglo-saxons avides (süchtig, hungrig) de sensations ? En tout cas, s’ils s’attendent à voir une crèche vivante dans laquelle Marie allaite l’enfant Jésus, ils risquent d’être déçus ! Au train où vont les choses (so wie die Dinge laufen), je m’étonne que personne n’ait encore eu l’idée d’une « crèche-reality show » – ou « nativity (set – reality) show » – ! Non seulement l’enfant Jésus serait allaité en public, mais « on » (pourquoi pas Joseph, un père « moderne »…) lui changerait ses couches (Windel) . Et l’opération serait sponsorisée par Pampers (ou toute autre marque intéressée par le projet) ! Ah, j’oubliais ! En France, les crèches (Weihnachtskrippen et pas Kinderkrippen…) sont interdites dans l’espace public, selon la lecture (Leseart) – littérale et controversée – de l’article (Paragraph) 28 de la loi de 1905 (Loi de séparation des Eglises et de l’Etat). L’installation d’une crèche dans un espace public peut être autorisée à condition qu’elle ait un caractère temporaire, pendant les fêtes de fin d’année, qu’elle présente « un caractère culturel [et pas cultuel…], artistique ou festif » et qu’elle n’exprime pas « la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse ». Elle doit également correspondre à des « usages locaux« . (d’après Wikipédia) |
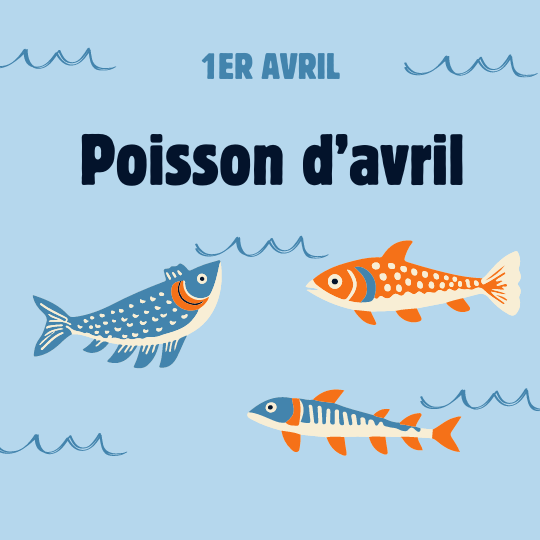 Par ex., le 1er avril 2015, un article du journal l’Obs prétendait que les
Par ex., le 1er avril 2015, un article du journal l’Obs prétendait que les 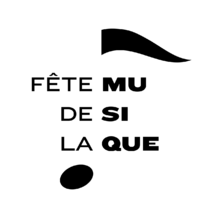
 Et, 50 jours à partir du dimanche de Pâques (soit 7 x 7 jours après cette fête), on célébrait les «
Et, 50 jours à partir du dimanche de Pâques (soit 7 x 7 jours après cette fête), on célébrait les «  Selon la coutume, pendant la messe de la Pentecôte, on faisait tomber de la voûte (Gewölbe) de l’église leurs larges pétales rouges pour rappeler les «
Selon la coutume, pendant la messe de la Pentecôte, on faisait tomber de la voûte (Gewölbe) de l’église leurs larges pétales rouges pour rappeler les «  Ce gâteau est une sorte de
Ce gâteau est une sorte de Il existe deux sortes de gâteaux des Rois
Il existe deux sortes de gâteaux des Rois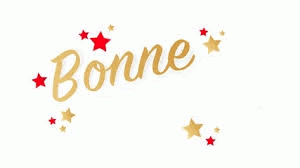
 L’étymologie de « Noël » n’est pas clairement établie. Alors que, dans la plupart des autres langues européennes, le mot se réfère directement à la naissance du Christ :
– on souhaite en allemand « Fröhliche Weihnachten » (joyeuse nuit sacrée),
– en anglais, « Merry Christmas; »> » (joyeuse messe de Christ),
– en espagnol « Feliz Navidad » (joyeuse nativité),
– en italien « Buone Feste Natalizie » (bonnes fêtes de nativité),
– en grec « Kala Christougenna » (joyeuse naissance du Christ) …
L’étymologie de « Noël » n’est pas clairement établie. Alors que, dans la plupart des autres langues européennes, le mot se réfère directement à la naissance du Christ :
– on souhaite en allemand « Fröhliche Weihnachten » (joyeuse nuit sacrée),
– en anglais, « Merry Christmas; »> » (joyeuse messe de Christ),
– en espagnol « Feliz Navidad » (joyeuse nativité),
– en italien « Buone Feste Natalizie » (bonnes fêtes de nativité),
– en grec « Kala Christougenna » (joyeuse naissance du Christ) …